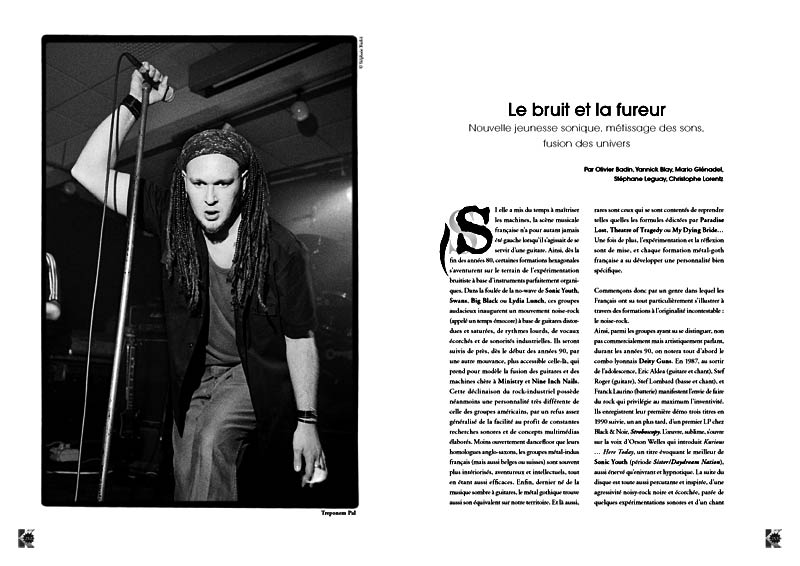| Si
elle a mis du temps à maîtriser les machines,
la scène musicale française n’a
pour autant jamais été gauche lorsqu’il
s’agissait de se servir d’une guitare.
Ainsi, dès la fin des années 80, certaines
formations hexagonales s’aventurent sur le terrain
de l’expérimentation bruitiste à
base d’instruments parfaitement organiques.
Dans la foulée de la no-wave de Sonic Youth,
Swans, Big Black ou Lydia Lunch, ces groupes audacieux
inaugurent un mouvement noise-rock (appelé un
temps émocore) à base de guitares distordues
et saturées, de rythmes lourds, de vocaux écorchés
et de sonorités industrielles.
Ils seront suivis de près, dès le début
des années 90, par une autre mouvance, plus accessible
celle-là, qui prend pour modèle la fusion
des guitares et des machines chère à Ministry
et Nine Inch Nails.
|
Cette déclinaison du rock industriel possède néanmoins une personnalité très différente de celle des groupes américains, par un refus assez généralisé de la facilité au profit de constantes recherches sonores et de concepts multimédias élaborés.
Moins ouvertement dancefloor que leurs homologues anglo-saxons, les groupes métal-indus français (mais aussi belges ou suisses) sont souvent plus intériorisés, aventureux et intellectuels, tout en étant aussi efficaces.
Enfin, dernier né de la musique sombre
à guitares, le métal gothique trouve
aussi son équivalent sur notre territoire.
Et là aussi, rares sont ceux qui se sont
contentés de reprendre telles quelles les
formules édictées par Paradise Lost,
Theatre of Tragedy ou My Dying Bride... Une fois
de plus, l’expérimentation et la
réflexion sont de mise, et chaque formation
métal-goth française a su développer
une personnalité bien spécifique.
.../...
Rédacteurs
:
O. Badin, Y. Blay, M. Glénadel, S. Leguay,
C. Lorentz
|
![]()